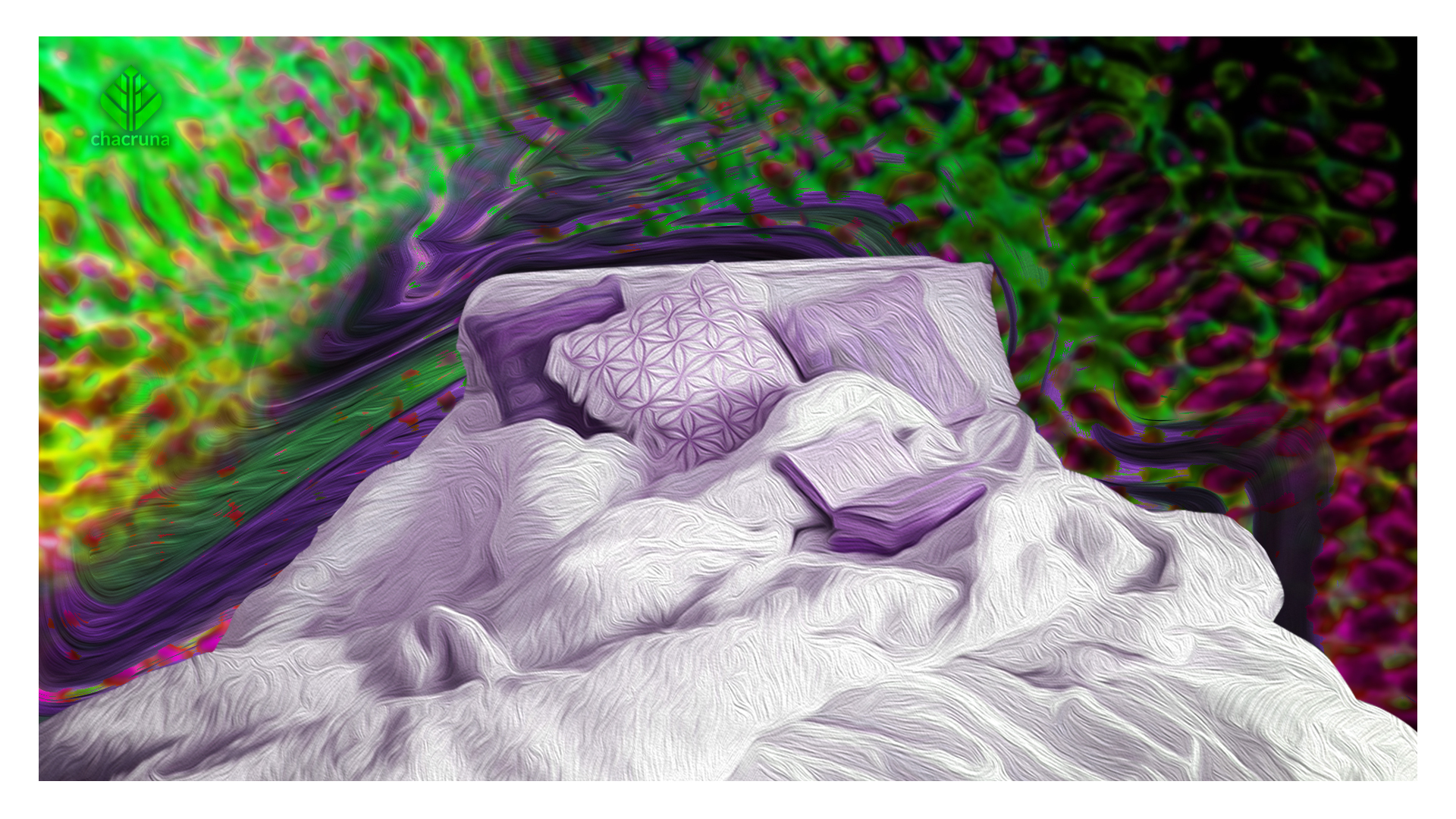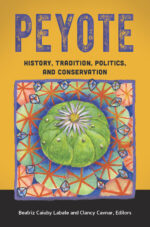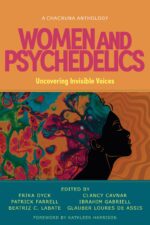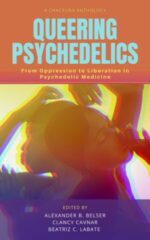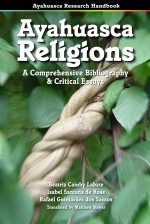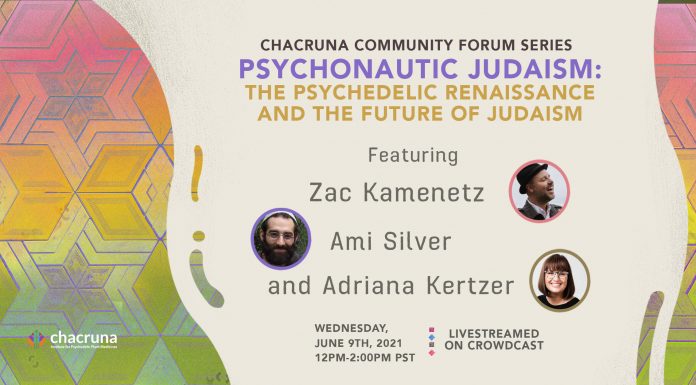- The Future of Sex and Psychedelics: An Agenda for Research - April 24, 2025
- L’avenir des recherches sur le sexe et les psychédéliques - April 24, 2025
- Women, Mental Illness and Psychedelic Therapy in Postwar France - October 25, 2023
- The Future of Sex and Psychedelics: An Agenda for Research - April 24, 2025
- L’avenir des recherches sur le sexe et les psychédéliques - April 24, 2025
- Acid and Orgasms: Why LSD Failed to Sexually Liberate Women - October 7, 2020
Dans un article récent publié dans Medical Humanities intitulé « Sex and psychedelics: a wide-lens look at a burgeoning field », nous examinons de manière critique l’intersection entre psychédéliques et sexualité, en plaidant pour une approche plus large et contextuellement informée de ce domaine émergent d’étude. Nous y soulignons l’importance d’intégrer des facteurs culturels, historiques et sociopolitiques dans l’analyse des psychédéliques et de leurs effets sur la sexualité humaine, remettant ainsi en question le cadre individualiste qui prédomine dans les recherches actuelles. Celles-ci se focalisent en effet sur des changements mesurables et mécanistes des notions de « fonction sexuelle » et de « bien-être sexuel », en dépit de l’histoire controversée de ces concepts diagnostiques. Bien que l’intérêt pour ce champ ait considérablement augmenté ces cinq dernières années, une grande partie de la littérature existante isole la sexualité des participant·es de contextes structurels, politiques et culturels plus larges, réduisant l’amélioration rapportée en matière de sexualité à une simple question d’optimisation personnelle et de plaisir.
Bien que l’intérêt pour ce champ ait considérablement augmenté ces cinq dernières années, une grande partie de la littérature existante isole la sexualité des participant·es de contextes structurels, politiques et culturels plus larges, réduisant l’amélioration rapportée en matière de sexualité à une simple question d’optimisation personnelle et de plaisir.
Des études récentes ont mis en lumière le potentiel des psychédéliques à influencer positivement la fonction et le bien-être sexuels. Nous avons choisi d’en examiner trois. Par exemple, Barba et al. (2024) ont mené une étude mixte approfondie en s’appuyant sur deux ensembles de données issus de participant·es ayant utilisé des psychédéliques « classiques » dans des environnements naturalistes et cliniques. Leurs résultats indiquent des améliorations cohérentes dans divers aspects de la fonction sexuelle, notamment le plaisir, la satisfaction, l’excitation, la communication et l’image corporelle, en particulier chez les participants masculins. Ces effets ont été corroborés par des mesures quantitatives, telles que la Flourishing Scale, qui a montré des augmentations statistiquement significatives au fil du temps. Dans une autre étude, Holka-Pokorska (2023) réalise une revue de la littérature systématique de près d’une centaine d’essais cliniques impliquant la MDMA, documentant des améliorations de la réactivité sexuelle, de l’intimité et de la performance globale. Une troisième étude qualitative à petite échelle menée par Jacobs et al. (2022) explore quant à elle l’utilisation du microdosage dans la thérapie de couple, les participant·es rapportant une augmentation de la confiance, de l’ouverture et de la satisfaction dans leurs relations. L’ensemble de ces résultats suggère que les psychédéliques détiennent un potentiel thérapeutique permettant de traiter les dysfonctions sexuelles et de renforcer l’intimité.
Cependant, nous voulons montrer que ces études, bien qu’elles établissent de manière constante une relation positive entre psychédéliques et sexualité, ne sont en fait pas si convaincantes, dans la mesure où elles déconnectent la sexualité de ses contextes sociaux, historiques et culturels. Ce cadrage reflète un discours néolibéral plus large, où la sexualité est réduite à une quête mécaniste et individuelle d’optimisation et d’amélioration de soi, transformant l’enrichissement des interactions et du plaisir sexuels en une entreprise quasi-entrepreneuriale. Dans cette perspective, les psychédéliques se transforment en simples outils d’amélioration du bien-être personnel, détachés des facteurs structurels qui façonnent les expériences d’intimité et de désir. Ce point de vue contribue ainsi à la « GOOPification » du bien-être sexuel et, plutôt que de participer à un projet plus large de libération sexuelle, risque de renforcer le sentiment d’échec ou d’insuffisance chez ceux qui n’en retirent pas les bénéfices promis, perpétuant l’idée que la satisfaction sexuelle dépend uniquement d’un effort et d’un choix personnel.
Nous sommes particulièrement critiques quant à la manière dont le concept de bien-être sexuel est défini et opérationnalisé dans la majeure partie de la littérature existante. Le plaisir est souvent confondu avec la satisfaction, sans que l’on prête suffisamment attention aux déterminants plus larges de la santé sexuelle. Par exemple, des études comme que celle de Barba et al. ne tiennent pas compte des pressions extérieures telles que l’insécurité économique ou le stress au travail, qui peuvent influencer de manière significative les expériences sexuelles. En se concentrant de manière étroite sur les résultats individuels, ces études occultent les manières dont les inégalités systémiques impactent les récits personnels d’intimité et de désir. Si l’usage des psychédéliques peut offrir un soulagement à court terme ou aider à surmonter certains problèmes sexuels, il ne saurait constituer une solution miracle aux conditions structurelles de difficultés et de précarité qui marquent la vie de nombreuses personnes, et qui contribuent sans doute à façonner notre culture sexuelle contemporaine. Si vous devez cumuler plusieurs emplois pour payer votre loyer et que vous êtes épuisé·e, il est difficile d’affirmer qu’un psychédélique fera une différence à long terme sur votre bien-être sexuel et votre fonction sexuelle, pas plus qu’il n’améliorera les conditions genrées et racialisées qui pèsent sur les individus, et donc sur leur sexualité. Quelles négociations une personne devra-t-elle mettre en place pour convaincre un·e partenaire, déjà peu enclin·e à se soucier de son plaisir sexuel, de prendre des psychédéliques afin d’améliorer leur relation sexuelle ? Et comment les psychédéliques peuvent-ils réduire « l’écart d’orgasme » documenté dans les couples hétérosexuels ?
Nous préconisons également une approche plus intersectionnelle dans ces études, qui prenne en compte l’interaction entre genre, classe, race et contexte culturel dans la détermination des effets des psychédéliques sur la sexualité. Comme nous le constatons, la grande majorité des participant·es aux recherches menées jusqu’à présent sont blancs et blanches, ont un haut niveau d’étude et sont issu·es de classe sociale aisées. Un échantillon plus diversifié et représentatif, intégrant une population nettement plus importante de personnes noires, autochtones et de couleur (BIPOC) ainsi qu’une plus grande diversité sexuelle et de classe, pourrait produire des résultats bien différents.
Nous montrons par exemple que les femmes ont historiquement fait face à un examen plus minutieux et à des jugements moraux exacerbés concernant leur usage des psychédéliques, et qu’elles s’appuient encore aujourd’hui souvent sur des discours de justification pour leurs consommations, qui se feraient seulement dans des cadres thérapeutiques ou spirituels. L’usage récréatif ou expérientiel féminin est ainsi encore largement tabou pour les femmes elles-mêmes. Pendant les mouvements contre-culturels des années 1960, les psychédéliques étaient célébrés comme des outils de libération, mais cette rhétorique masquait des dynamiques de pouvoir profondément enracinées dans les rapports de genre. Les femmes étaient fréquemment incitées à participer à des pratiques sexuelles psychédéliques privilégiant le plaisir masculin, renforçant ainsi les normes patriarcales plutôt que de les remettre en cause. La recherche contemporaine semble toujours refléter ces dynamiques, avec des études rapportant des effets positifs moins marqués pour les femmes que pour les hommes, particulièrement dans les rapports entre partenaires. Nous suggérons que ces disparités découlent des attentes sociétales et des stéréotypes de genre qui influencent tant l’expérience des participant·es que l’interprétation des chercheurs et chercheuses.
Les questions éthiques autour de la sexualité dans les espaces psychédéliques constituent également un enjeu crucial de notre analyse. Les psychédéliques amplifient la sensibilité émotionnelle et la suggestibilité, soulevant des questions complexes de consentement et de pouvoir dans les contextes thérapeutiques. Le concept de « pharmacosuggestibilité » met ainsi en lumière la vulnérabilité accrue des individus sous l’influence des psychédéliques aux signaux externes et aux figures d’autorité. Historiquement, les réactions sexuelles dans les thérapies psychédéliques—aujourd’hui éludées dans le discours contemporain—étaient reconnues et prises en compte par les praticien·nes. Les premier·es thérapeutes formé·es à l’usage des psychédéliques savaient reconnaître et gérer ces réactions, les considérant comme un aspect naturel, parfois même thérapeutique, des états modifiés induits par le LSD. Certain·es mettaient en place des stratégies spécifiques pour gérer ces situations, afin de maintenir des limites éthiques tout en permettant aux patient·es de traiter ces informations et d’explorer ces expériences dans le cadre thérapeutique. D’autres, en revanche, ont usé de pratiques répréhensibles en exploitant les états altérés des patient·es pour des gains personnels ou sexuels, abus qui persistent malheureusement. Nous soutenons que les directives cliniques actuelles contournent souvent la discussion sur les réactions sexuelles, peut-être par souci de légitimer le champ et de se distancier de son passé contre-culturel. Cette omission crée d’importantes lacunes dans la formation des thérapeutes et la protection des patient·es, d’où notre appel à l’élaboration de directives éthiques abordant explicitement le potentiel des réponses sexuelles en thérapie.
Nous estimons que les recherches futures devraient impliquer davantage les communautés marginalisées, telles que les personnes LGBTQ+ et les travailleur·ses du sexe, dont les perspectives ont été historiquement exclues des discussions officielles sur les psychédéliques et la sexualité. Ces groupes offrent des aperçus précieux sur les dimensions éthiques et politiques de l’intimité, notamment en ce qui concerne les dynamiques de pouvoir, le consentement et l’autonomie. Nous préconisons également une approche interdisciplinaire, puisant dans la sociologie, l’anthropologie et l’histoire, pour situer les expériences psychédéliques dans leurs contextes sociaux et culturels plus larges.
En insistant sur l’importance du contexte culturel et social, nous appelons le champ à dépasser ses préoccupations actuelles d’optimisation et d’amélioration de soi, pour adopter une approche plus nuancée et inclusive qui reconnaisse la diversité des expériences humaines et les forces politiques structurelles qui les façonnent.
Finalement, nous montrons que les recherches actuelles se limitent souvent en réduisant des phénomènes sociaux complexes à des problématiques individualisées susceptibles de solutions pharmacologiques. En insistant sur l’importance du contexte culturel et social, nous appelons le champ à dépasser ses préoccupations actuelles d’optimisation et d’amélioration de soi, pour adopter une approche plus nuancée et inclusive qui reconnaisse la diversité des expériences humaines et les forces politiques structurelles qui les façonnent. Cet article se veut à la fois une critique de l’état actuel de la recherche et un appel à l’action pour les universitaires, clinicien·nes et décideur·ses politiques. En pointant les lacunes et en élargissant le champ de l’étude des psychédéliques et de la sexualité, il ouvre la voie à une compréhension plus riche et équitable de la manière dont ces substances interagissent avec l’intimité humaine.
Note: L’exposition « Higher Love: The Psychedelic Roots of Modern Sexuality », organisée par Dubus et Dymock, a ouvert ses portes le 28 mars au Museum of Sex de New York. En savoir plus ici.
Note: Lisez la version anglaise de cet article ici.
Art by Mariom Luna.
Références
Tommaso Barba, Hannes Kettner, Caterina Radu, Joseph M. Peill, Leor Roseman, David J. Nutt, David Erritzoe, Robin Carhart-Harris et Bruna Giribaldi, « Psychedelics and sexual functioning: a mixed-methods study », Scientific Reports, 14-1, 2024, p. 2181.
Alex Dymock et Zoe Dubus, « Sex and psychedelics: a wide-lens look at a burgeoning field », Medical Humanities, 2025.
Justyna Holka-Pokorska, « Can research on entactogens contribute to a deeper understanding of human sexuality? », Pharmacological Reports, 75-6, 2023, p. 1381‑1397.
Lucy Jacobs, Samantha Banbury et Joanne Lusher, « Micro-dosing psychedelics as a plausible adjunct to psychosexual and couple’s therapy: a qualitative insight », Sexual and Relationship Therapy, 39-3, 2022, p. 791‑804.

Shop our Collection of Psychedelic T-Shirts
Take a minute to browse our stock:
Did you enjoy reading this article?
Please support Chacruna's work by donating to us. We are an independent organization and we offer free education and advocacy for psychedelic plant medicines. We are a team of dedicated volunteers!
Can you help Chacruna advance cultural understanding around these substances?